Sclérose en plaques récurrente-rémittente
Il est temps d’AGIR. Retrouvez la brochure qui résume les quatre piliers de la prise en charge.
Adapté de Ubbink et al. 2022.18
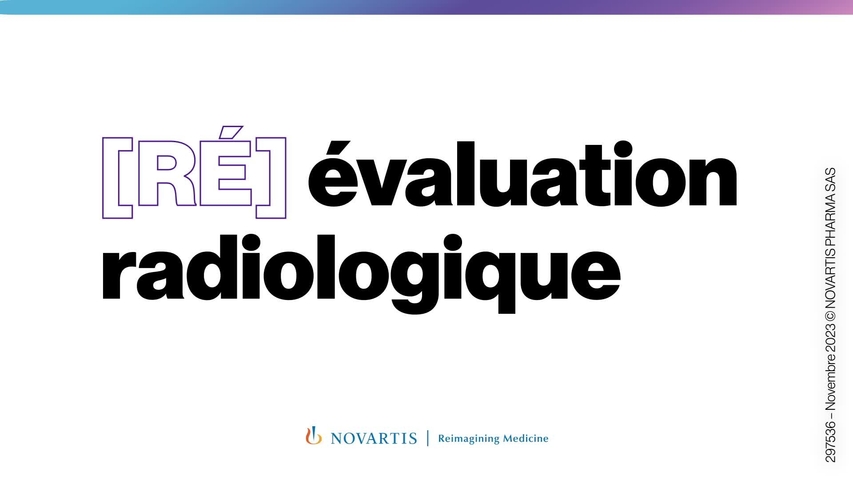 VIDEO
VIDEO
Pour visionner les vidéos du Pr Stéphane KREMER expliquant l’importance du protocole OFSEP et ses modalités, cliquez ci-dessus.
Mekies C, et al. Critères d’évaluation d’efficacité d’un traitement de première ligne dans la sclérose en plaques en pratique courante. Pratique Neurologique - FMC 2022;13(2):86-93.
Ministère de la santé et de la prévention. La sclérose en plaques. [En ligne] https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-sclerose-en-plaques. Mise à jour le 15/02/2023. Consulté le 01/08/2023.
Wijmeersch B.V. et al. Using personalized prognosis in the treatment of relapsing multiple sclerosis : A practical guide. Front Immunol. 2022;13:991291.
Pardo G, et al. The sequence of disease-modifying therapies in relapsing multiple sclerosis: safety and immunologic considerations. J Neurol. 2017;264(12):2351-2374.
Bigaut K, de Sèze J. Relais thérapeutiques dans la sclérose en plaques. Pourquoi et comment ? Neurologies. 2022;25(246):72-78.
Weinstock-Guttman B. et al. Predicting Long-term Disability in Multiple Sclerosis: A Narrative Review of Current Evidence and Future Directions. Int J MS Care. 2022;24(4):184-188.
Canto E. et al. Chitinase 3-like I: prognostic biomarker in clinically isolated syndromes. Brain. 2015;138(Pt 4):918-931.
Hegen H. et al. Cerebrospinal fluid kappa free light chains as biomarker in multiple sclerosis – from diagnosis to prediction of disease activity. Wien Med Wochenschr. 2022;172(15-16):337-345.
Hosny H.S. et al. Predictors of severity and outcome of multiple sclerosis relapses. BMC Neurol. 2023;23(1):67.
Montalban X, et al. ECTRIMS/EAN guideline on the pharmacological treatment of people with multiple sclerosis. Mult Scler. 2018;24(2):96-120.
Freeman L, et al. High-Efficacy Therapies for Treatment-Naïve Individuals with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. CNS Drugs. 2022;36(12):1285-1299.
Ziemssen T, et al. Optimizing treatment success in multiple sclerosis. J Neurol. 2016;263(6):1053-1065.
Comi G, et al. Evolving concepts in the treatment of relapsing multiple sclerosis. Lancet. 2017;389(10076):1347-1356.
SFSEP. L’echelle EDSS.
Lefort M, et al. OFSEP investigators. Disability Progression in Multiple Sclerosis Patients using Early First-line Treatments. Eur J Neurol. 2022;29(9):2761–2771.
Wiendl H, et al. Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group (MSTCG): position statement on disease-modifying therapies for multiple sclerosis (white paper). Ther Adv Neurol Disord. 2021;14:17562864211039648.
Kania K, et al. Prevalence and prognostic value of prodromal symptoms in relapsing-remitting multiple sclerosis. Neurol Neurochir Pol. 2023;57(3):289-296.
Ubbink DT, et al. Shared decision-making in patients with multiple sclerosis. Front Neurol. 2022;13:1063904.
Kappos L, et al. Contribution of Relapse-Independent Progression vs Relapse-Associated Worsening to Overall Confirmed Disability Accumulation in Typical Relapsing Multiple Sclerosis in a Pooled Analysis of 2 Randomized Clinical Trials. JAMA Neurol. 2020;77(9):1132-1140.
OFSEP. Protocole IRM OFSEP. POS-COH-01f Version : 2.0. Date de mise en application : 20/07/2020.
HAS. PROMs – Comment les mettre en oeuvre ? Mai 2023.
Kluzek S. et al. Patient-reported outcome measures (PROMs) as proof of treatment efficacy. BMJ EBM. 2022;23(3):153-155.
Van Munster C.E.P. et Uitdehaag B.M.J. Outcome Measures in Clinical Trials for Multiple Sclerosis. CNS Drugs. 2017;21:217-236.
HAS. Qualité des soins perçue par le patient – Indicateurs PROMs et PREMs – Panorama d’expériences étrangères et principaux enseignements. Validé par le Collège le 1er juillet 2021.
Zhang X, et al. The prevalence and risk factors of anxiety in multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Front. Neurosci. 2023. 17:1120541. doi: 10.3389/fnins.2023.1120541.
Traiter avec un traitement de 2ème ligne en cas de réponse thérapeutique insuffisante (Chalmer)
Patients en échec de traitement de 1ère ligne (Chalmer).
Analyse d’une cohorte danoise de patients atteints de SEP-RR inclus entre 1998 et 2015 dont le but était de comparer...












